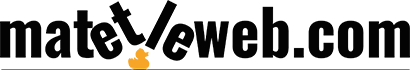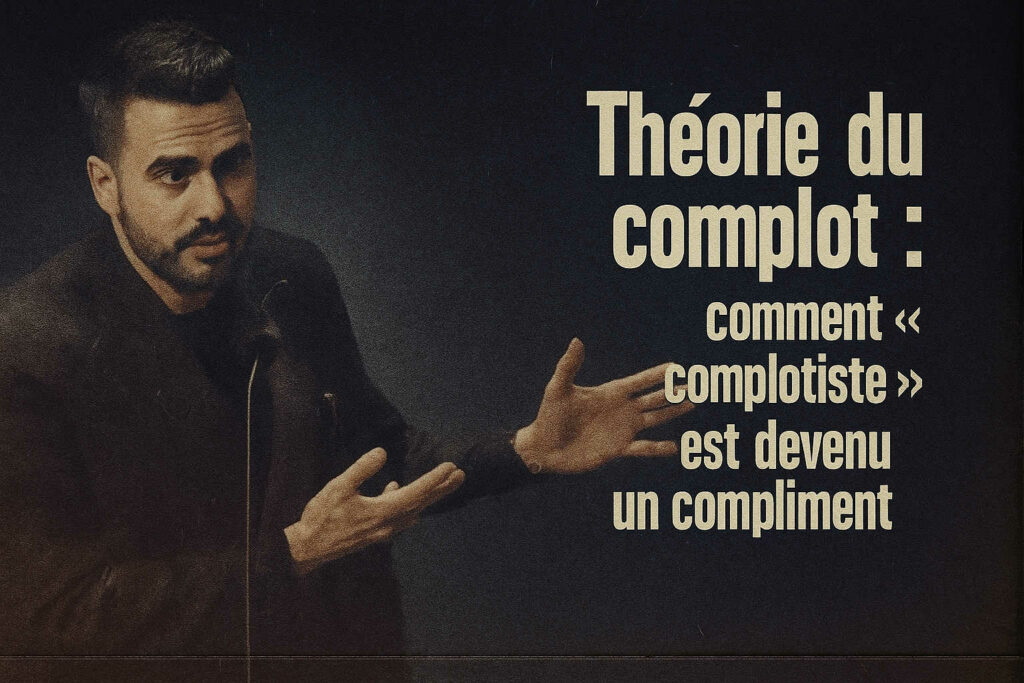
Théorie du complot : comment « complotiste » est devenu un compliment en 2025
De terme d’historien à étiquette infamante, puis à cri de ralliement : la trajectoire du mot « complotiste » raconte un siècle de luttes sémantiques, de censure feutrée et de réflexes de conformité. À l’automne 2025, une conférence donnée aux Universités d’Automne de l’UPR propose une relecture offensive : revendiquer le droit au doute et désinstaller un demi-siècle de « terrorisme intellectuel ».
Un mot qui a changé de camp
Au départ, conspiracy theory n’a rien d’une injure. Dans son History of the United States (1910), l’historien James Ford Rhodes emploie l’expression pour désigner — de manière positive et constatée — la stratégie d’influence des esclavagistes sur Washington, aux origines de la guerre de Sécession. Autrement dit : une hypothèse raisonnable, appelée à être confirmée ou infirmée par le travail critique.
Le basculement sémantique intervient après 1963 : l’assassinat de Kennedy cristallise les controverses et l’expression « théorie du complot » est instrumentalisée pour disqualifier les lectures alternatives. Des memoranda de l’époque seront souvent cités comme moment-clé de ce retournement, où l’expression devient un péjoratif réflexe chargé d’arrêter la conversation avant qu’elle ne commence.
Du « terrorisme intellectuel » à la souveraineté de l’esprit
Le cœur de la démonstration tient en une thèse : rendre suspect le questionnement par un stigmate, « complotiste », qui colle à la peau et dissuade la contradiction. La mécanique est connue : conformité (Asch), soumission à l’autorité (Milgram), pression des normes (Sherif), jusqu’à l’impuissance apprise (Seligman). S’ajoutent des « codes de la route » implicites : sources autorisées vs interdites, sujets classables vs intouchables.
« La meilleure école de la souveraineté, c’est la culture. »
Idriss Aberkane
L’antidote proposé est culturel et éthique : reconstruire une hygiène du doute, vérifier, sourcer, falsifier — plutôt qu’anathémiser. Le conférencier pousse l’aphorisme jusqu’au coup de poing : « Si vous n’êtes pas complotiste, vous n’êtes pas journaliste. » Entendez : sans esprit critique, pas d’information digne de ce nom.
Quand l’insulte devient étendard
L’histoire des idées fourmille de mots passés du mépris à la fierté : « gothique », « baroque », « romantique », « punk », « queer »… Ce retournement du stigmate est au cœur de la stratégie proposée : assumer l’étiquette, la retourner, et s’en servir pour rouvrir l’enquête là où l’on avait apposé un sens interdit de la pensée.
Études de cas, controverses et méthode
La conférence enchaîne plusieurs cas d’école (guerres de narration, modération des plateformes, propagandes de guerre, lectures médiatiques inversées). Ils sont présentés comme des hypothèses de travail à examiner, non comme des axiomes. L’angle n’est pas de trancher à la place du lecteur, mais de réhabiliter la possibilité d’enquêter publiquement, sans procès d’intention automatique.
Repères & précisions
- Cadre : Conférence aux Universités d’Automne de l’UPR (2025). Le présent article restitue l’argumentaire du conférencier et attribue ses affirmations ; il invite à leur vérification critique.
- Concepts-clés : renversement sémantique, gaslighting, conformité sociale, « terrorisme intellectuel », souveraineté intellectuelle.
- Référence historique : emploi non péjoratif de « conspiracy theory » chez James Ford Rhodes (1910), à propos des réseaux esclavagistes.
Synthèse — Ce qu’il faut retenir
1) Historiquement, « théorie du complot » désigne d’abord une hypothèse sérieuse sur un fait politique (Rhodes, 1910). 2) Après 1963, l’usage disqualifiant s’installe pour neutraliser des controverses sensibles. 3) La stigmatisation « complotiste » opère via la conformité et la peur sociale. 4) En 2025, une contre-culture du doute en fait un badge de désobéissance civique : on ne croit pas « à tout », on enquête.