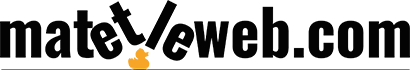Au 107e congrès des maires de France, le nouveau chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, a lâché une phrase qui glace : « Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. » Devant des élus venus parler crèches, voirie et budgets locaux, on a soudain parlé sacrifice, guerre avec la Russie et horizon « 3 à 4 ans ». Simple discours de dissuasion, ou préparation psychologique du pays à une économie de guerre et à un basculement stratégique majeur ?
En résumé : à partir de la transcription intégrale de son discours et de l’analyse de Georges Kuzmanovic (Fréquence Populaire), cet article décortique trois niveaux : le récit officiel d’un monde en crise où la France devrait se préparer à un « choc » avec la Russie, la critique d’une rhétorique guerrière difficilement compatible avec la dissuasion nucléaire, et enfin l’usage politique de cette peur dans un pays déjà traversé par une crise sociale, budgétaire et démocratique profonde.
Voir la vidéo de Fréquence Populaire
1. Une phrase qui claque au milieu des stands de collectivités
La scène se déroule au congrès annuel des maires de France. Normalement, c’est le rendez-vous des problèmes concrets : assainissement, écoles, police municipale, dotations d’État. Cette fois, c’est le chef d’état-major des armées en personne qui monte sur la tribune principale : le général d’armée aérienne Fabien Mandon, nommé à ce poste au 1er septembre 2025 après avoir été très proche de l’Élysée comme chef d’état-major particulier du président Macron.
Son discours commence comme un « tour d’horizon stratégique » classique : désengagement progressif des États-Unis du flanc Est de l’OTAN, montée en puissance militaire de la Chine, guerre de haute intensité en Ukraine, terrorisme au Sahel, instabilité au Proche-Orient, tensions sur les routes maritimes. Tout est construit pour dessiner un monde qui « se dégrade ».
Puis arrive la séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux :
« Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. »
Et le général d’ajouter que cette « force d’âme » doit être préparée dès maintenant, dans les communes, par les maires eux-mêmes. Il leur demande explicitement de devenir les relais de la pédagogie guerrière : expliquer l’effort budgétaire, accepter des manœuvres militaires sur leurs territoires, défendre une industrie d’armement présentée comme une chance économique locale.
Ce n’est pas un dérapage capté à la volée, mais une formule répétée, reprise mot pour mot dans plusieurs comptes rendus officiels et articles de presse. Elle a immédiatement suscité un flot de réactions indignées, notamment dans les milieux souverainistes et anti-atlantistes, qui y voient un signal de préparation à la guerre totale.
2. Ce que dit vraiment le général Mandon
2.1 Un récit du monde en train de basculer
Dans sa longue intervention, le général Mandon déroule un récit cohérent, presque pédagogique, du monde vu depuis l’état-major :
- Les États-Unis se « désengagent » progressivement de l’Europe pour concentrer leurs forces sur l’Asie et la rivalité avec la Chine, retirant par exemple des troupes de Roumanie malgré la guerre en Ukraine.
- La Chine est décrite comme une puissance démographique, économique et désormais militaire, capable de rivaliser technologiquement avec Washington, avec un horizon de conflit autour de Taïwan évoqué pour 2027 par les stratèges américains.
- La Russie, enfin, est présentée comme une puissance en guerre qui ne s’arrêtera pas à l’Ukraine : Mandon rappelle la Géorgie (2008), la Crimée (2014) puis l’invasion de 2022, avant d’affirmer que Moscou se prépare « à une confrontation à l’horizon 2030 » avec les pays de l’OTAN.
Pour lui, il serait illusoire de croire à une paix durable : « Il n’y a aucune raison d’imaginer que c’est la fin de la guerre sur notre continent », insiste-t-il. Les Russes seraient convaincus que les Européens sont « faibles », ce qui les encouragerait à pousser leur avantage.
Face à ce tableau très sombre, il oppose un message double : d’un côté, il répète que « nous sommes fondamentalement plus forts que la Russie », si l’on additionne les armées et les industries de défense européennes ; de l’autre, il estime que cette supériorité ne vaut que si les sociétés acceptent le coût humain, économique et psychologique d’un conflit de haute intensité.
2.2 Un horizon de « choc dans 3 à 4 ans »
Ce n’est pas la première fois que le chef des armées fixe un horizon temporel. Devant la commission Défense de l’Assemblée nationale, il a déjà appelé l’armée française à se préparer à un « choc dans trois à quatre ans » face à la Russie.
Au congrès des maires, il reprend cette échéance, mais l’élargit à la société entière : les forces armées doivent être prêtes militairement, mais la Nation doit l’être psychologiquement, budgétairement, politiquement. La « base arrière », c’est-à-dire les familles, les écoles, les services publics locaux, doit tenir pour que les soldats acceptent de partir au combat.
C’est là que surgit la phrase-choc : si la France ne se prépare pas à « perdre ses enfants » et à « souffrir économiquement » pour financer l’effort de défense, alors elle serait « en risque ». L’ennemi n’est plus seulement aux frontières : c’est la supposée faiblesse intérieure, la réticence des populations au sacrifice.
2.3 Les maires transformés en courroie de transmission
Le cœur politique du discours tient dans la mission assignée aux élus locaux. Mandon leur explique que la défense « se construit localement » et que la conscience stratégique des Français se fabrique dans les communes : correspondants défense, cérémonies au monument aux morts, accueil des familles de militaires, acceptation de manœuvres sur le territoire.
En un mot, il leur demande de relayer la nouvelle doctrine : sortir d’une société persuadée que la paix serait acquise, pour l’habituer à l’idée que la guerre de haute intensité est redevenue une option réaliste – et qu’elle pourrait coûter « nos enfants ».
C’est ce glissement, du registre technico-stratégique au registre quasi moral, qui fait réagir. Et c’est précisément ce que relève l’analyse de Georges Kuzmanovic pour Fréquence Populaire.
3. La lecture de Georges Kuzmanovic : une préparation des esprits
Georges Kuzmanovic n’est pas un commentateur neutre du débat stratégique français. Ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales, aujourd’hui président du mouvement souverainiste République souveraine et rédacteur en chef du média Fréquence Populaire, il développe depuis des années une critique radicale de l’OTAN et de l’alignement atlantiste de la France.
Dans la vidéo dont est issue la transcription, il ne se contente pas de s’indigner de la formule « perdre nos enfants ». Il démonte l’architecture entière du discours.
3.1 Une histoire tronquée de la guerre en Ukraine
Première cible : l’historique du conflit en Ukraine tel que le résume le général Mandon. Celui-ci évoque 2008 (guerre en Géorgie), 2014 (annexion de la Crimée) puis 2022 (invasion de l’Ukraine) comme une suite d’agressions russes dans un contexte de « non-provocation » occidentale.
Kuzmanovic rappelle au contraire des éléments absents du discours militaire :
- le sommet de Bucarest de l’OTAN (2008) où est évoquée l’adhésion future de l’Ukraine et de la Géorgie ;
- les promesses non tenues sur la non-extension de l’Alliance vers l’Est après la fin de l’URSS ;
- les installations de systèmes antimissiles américains en Pologne et en Roumanie dès les années 2010, officiellement contre l’Iran mais perçus par Moscou comme une menace directe ;
- les événements de Maïdan en 2014, qualifiés de « coup d’État » par une partie des analystes, et la guerre civile qui s’ensuit dans le Donbass, avant même l’intervention militaire ouverte de la Russie.
Autrement dit, là où le général présente une Russie soudainement agressive, Kuzmanovic insiste sur une longue séquence d’escalade et de provocations réciproques, au cours de laquelle l’OTAN aurait systématiquement franchi les lignes rouges annoncées par le Kremlin.
On peut évidemment contester certaines de ses formulations – de nombreux historiens refusent par exemple le terme de « coup d’État » pour désigner Maïdan – mais l’enjeu est ailleurs : montrer ce que le récit militaire officiel laisse de côté, et comment ce silence prépare l’opinion à un futur affrontement présenté comme presque « naturel ».
3.2 La dissuasion nucléaire mise de côté
Deuxième point central de sa critique : la logique de dissuasion. La France comme la Russie sont des puissances nucléaires majeures, dotées de capacités de « seconde frappe » – en clair, la possibilité de détruire l’adversaire même après avoir été elles-mêmes dévastées.
Or toute la doctrine de dissuasion repose sur un principe simple : un conflit direct entre puissances nucléaires est, par nature, suicidaire, et donc impensable. C’est la fameuse « destruction mutuelle assurée » théorisée pendant la guerre froide.
Kuzmanovic souligne donc l’incohérence d’un discours qui, d’un côté, rappelle que la dissuasion française rend très improbable une attaque directe contre le territoire national, et, de l’autre, parle sereinement d’une « confrontation majeure » avec la Russie dans trois ou quatre ans, au point d’envisager le sacrifice de dizaines de milliers de jeunes soldats.
Pour lui, évoquer la mort de « nos enfants » dans une guerre de haute intensité contre une autre puissance nucléaire revient à brouiller la frontière entre dissuasion (empêcher la guerre) et préparation à la guerre (l’anticiper comme probable, voire souhaitable pour « tenir son rang »).
3.3 Le suivisme atlantiste comme impasse stratégique
Enfin, Kuzmanovic replace l’ensemble dans ce qu’il considère comme l’impasse stratégique française : un suivisme atlantiste qui conduit Paris à s’aligner sur les objectifs américains et de l’OTAN, sans débat démocratique sérieux sur les intérêts propres de la France.
Il cite les interventions en Afghanistan, au Sahel, l’engagement massif en Ukraine, et observe que les objectifs affichés (« lutte contre le terrorisme », « défense des valeurs », « protection de l’ordre international ») sont rarement évalués au regard des intérêts concrets du pays : souveraineté énergétique, industrie, stabilité européenne, sécurité intérieure.
Dans ce cadre, l’appel de Mandon à « accepter de perdre nos enfants » serait moins une prise de conscience lucide qu’un pas de plus dans une fuite en avant : on renonce à interroger les choix d’alliance pour préparer mentalement la population à payer le prix de ces choix.
4. Entre rhétorique guerrière et absence de préparation réelle
L’un des points les plus frappants de l’analyse de Kuzmanovic porte sur le décalage entre la radicalité du discours et la réalité de la préparation militaire française.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement met en avant une hausse importante du budget de la Défense et une nouvelle loi de programmation militaire. Mais sur le terrain, les armées alertent régulièrement sur des manques : stocks de munitions insuffisants, difficultés de recrutement, retards industriels.
Mandon lui-même reconnaît que les armées françaises restent dimensionnées pour des opérations extérieures limitées, pas pour une guerre de haute intensité prolongée sur le continent. D’où son insistance sur le réarmement, la montée en puissance des réserves, les investissements industriels.
Kuzmanovic en tire une conclusion plus politique : si l’on n’a pas sérieusement préparé le pays sur le plan matériel pendant trois ans et demi de guerre en Ukraine, pourquoi ce soudain discours sur l’urgence d’accepter le sacrifice suprême ? Pourquoi maintenant, et pourquoi devant des maires ?
Pour lui, la réponse tient dans le registre symbolique : il s’agit moins de préparer concrètement une armée à la guerre que de préparer les esprits à accepter une nouvelle hiérarchie des priorités budgétaires et politiques, où la défense passerait devant la santé, l’éducation ou la protection sociale.
5. Préparer les esprits ou détourner l’attention ?
Dernier étage de l’analyse : la situation intérieure française. Inflation, crise du logement, services publics à bout de souffle, endettement public sous pression de Bruxelles, tensions sociales sourdes… Dans ce contexte, que signifie demander à la population d’« accepter de souffrir économiquement » pour financer l’effort de défense ?
Kuzmanovic avance une hypothèse lourde : la rhétorique de la guerre servirait aussi à détourner l’attention des causes intérieures de la crise et des choix politiques passés (désindustrialisation, dépendance énergétique, politiques d’austérité), en désignant un nouvel horizon mobilisateur : l’affrontement avec la Russie et, en toile de fond, le choc des empires (États-Unis / Chine / Russie) dont l’Europe serait le terrain de jeu plutôt que l’acteur autonome.
On peut ne pas partager toutes ses conclusions. Mais une question demeure, difficile à balayer : dans quelle mesure ce type de discours construit-il un consentement à la guerre, même « limitée », dans une société qui n’a plus connu de mobilisation générale depuis des générations ?
Et surtout : qui décide, à quel moment, que le sacrifice de « nos enfants » serait « nécessaire » – et pour défendre quels intérêts ?
6. Entre dissuasion, paix et démocratie : ce que révèle vraiment ce discours
Au fond, l’affaire Mandon met à nu trois failles majeures de notre débat public.
6.1 Une dissuasion nucléaire sans débat
La France dispose d’une force de frappe nucléaire présentée comme le cœur de sa souveraineté stratégique. Mais la société discute très peu de ce que cela implique concrètement : quelles sont les lignes rouges ? Dans quelles circonstances l’arme serait-elle utilisée ? Comment articuler dissuasion et diplomatie ?
En parlant de manière presque banale du sacrifice de la jeunesse dans un conflit avec une autre puissance nucléaire, le discours de Mandon révèle une dissonance : soit la dissuasion fonctionne, et le scénario d’une guerre frontale avec la Russie reste extrêmement improbable ; soit on considère qu’elle ne suffit plus, et il faut alors rouvrir un débat démocratique profond sur notre stratégie.
6.2 Une Europe prise entre trois feux
Deuxième faille : la position européenne. Dans son tour d’horizon, le général décrit une Europe objectivement fragile : dépendante de la protection américaine, incapable de parler d’une seule voix, mais dotée d’une immense capacité industrielle et démographique qui pourrait, en théorie, la rendre plus forte que la Russie.
La question est donc moins militaire que politique : l’Europe veut-elle être un pôle autonome capable de négocier à égalité avec Moscou et Washington, ou rester un théâtre d’opérations où se rejouent les rivalités des grandes puissances ? Le discours entendu au congrès des maires penche clairement vers la seconde option : il nous invite à accepter les règles du jeu de l’OTAN, sans en discuter les alternatives.
6.3 Une démocratie sommée d’avaliser le sacrifice
Enfin, le choix du lieu – un congrès d’élus locaux – n’est pas anodin. En parlant à ceux qui sont « au contact » du pays, Mandon court-circuite en partie le débat parlementaire et médiatique pour s’adresser directement aux relais de proximité.
On peut y voir une forme de transparence : dire les choses, ne pas bercer la population d’illusions sur les risques du monde. Mais on peut aussi y voir une manière d’ancrer, dans le quotidien même de la République, l’idée que la guerre de haute intensité est redevenue une option normale – et que la seule véritable question serait de savoir si la population aura « la force d’âme » de suivre.
À ce stade, une chose est sûre : si l’on demande à un pays « d’accepter de perdre ses enfants », alors le pays est en droit d’exiger autre chose qu’une rhétorique anxiogène : un débat public honnête sur nos alliances, sur nos intérêts, sur les chemins de la paix autant que sur les scénarios de guerre.
Et ce débat ne peut pas être réservé aux états-majors, pas plus qu’aux seuls congrès des maires.
Article rédigé à partir de la transcription intégrale du discours du général Fabien Mandon au congrès des maires de France, de l’analyse de Georges Kuzmanovic pour Fréquence Populaire, et de différentes sources de presse revenant sur ces déclarations.