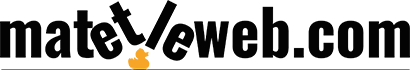Effondrement en cours ? Pablo Servigne, dix ans après, clarifie la collapsologie
Dix ans après Comment tout peut s’effondrer, Pablo Servigne revient — calmement, méthodiquement — sur un malentendu public : l’effondrement n’est pas un « jour J », c’est un processus. Dans un monde d’« exponentielles » et de chocs en cascade, l’auteur défend une idée simple mais radicale : seuls des liens sociaux denses amortissent les crises et évitent la spirale de la peur. Une thèse qui bouscule, loin des clichés survivalistes.
L’EFFONDREMENT A COMMENCÉ — entretien avec Pablo Servigne (réal. : Maxime Thuillez, Académie du Climat).
Résumé — Servigne soutient que l’effondrement est déjà à l’œuvre, non comme une apocalypse soudaine mais comme une transition chaotique faite de bascules écologiques, énergétiques et politiques. Face à la convergence des risques (climat, biodiversité, énergie, autoritarismes, IA…), la boussole n°1 n’est ni la fuite ni le bunker : c’est l’entraide, la préparation « générique » par le tissu social (voisinage, institutions, culture du risque), et la sortie des verrouillages sociotechniques qui rendent la décroissance « impensable » dans la mégamachine.
Dix ans après Comment tout peut s’effondrer : lever le malentendu
En 2015, la « collapsologie » mettait un mot sur une intuition collective : notre civilisation peut chuter. En 2025, Servigne nuance : elle ne s’écroule pas en un soir, elle glisse. Des « signaux d’alerte précoces » (écosystèmes, climat, économie) dessinent une pente ; les historiens de demain débattront de la date de départ, mais nous sommes déjà dans la transition.
« L’effondrement, ce n’est pas un moment : c’est un processus qui prend du temps… et nous sommes au milieu. »
Pablo Servigne
Des « exponentielles » partout : signaux d’alerte et bascules
La biodiversité décroche, parfois plus vite que les modèles ; des courants océaniques clés montrent des signes de fatigue ; l’économie multiplie amortisseurs et algorithmes pour éviter ses propres « collapses ». Dans ce paysage, les risques convergent : un choc peut en déclencher d’autres. Le récit qui s’impose n’est pas celui d’un cataclysme hollywoodien, mais d’un enchevêtrement de crises à gérer — localement et socialement.
Biodiversité, climat, systèmes humains : la mécanique des points de bascule
Des lacs passent du clair au trouble, des forêts s’embrasent plus souvent, des chaînes d’approvisionnement se fragmentent… Les « early warning signals » existent autant en écologie qu’en macroéconomie. Comprendre ces seuils, c’est admettre que la prévention (plutôt que la prédiction fine) demeure notre meilleur pari.
« On ne sait pas dater le futur. Mais on peut agir comme si la catastrophe était certaine, pour justement l’éviter. »
Pablo Servigne, à propos du « catastrophisme éclairé »
Pétrole, alimentation, dépendances : l’angle mort qui persiste
Le pétrole « facile » a été brûlé ; l’agro-industrie dépend du gaz (engrais azotés), du diesel (tracteurs), du plastique (chaînes du froid). Nous mangeons littéralement du pétrole. Ce constat demeure mal intégré dans le débat public, écrasé par l’urgence climatique. Or la combinaison pénuries + déstabilisation pourrait frapper vite et fort.
La mégamachine et ses verrous
Notre système est conçu pour accélérer. Freiner brutalement, c’est la panne assurée : marchés, bourses, dettes, infrastructures… Tout pousse à la croissance. C’est là l’obsession de Servigne : desserrer les verrous sociotechniques (habitudes, normes, rentes, architectures techniques) qui figent l’imaginaire et rendent inavouable le mot « décroissance ».
« Si l’on dit “on ralentit”, la fusée s’écrase : elle n’a pas été conçue pour redescendre en douceur. »
Pablo Servigne
Autoritarismes, peurs et récits : pourquoi l’entraide est stratégique
Dans les phases de chaos, la tentation autoritaire prospère : une réponse simple à des problèmes complexes, qui aggrave la violence et précipite la chute. La clé ? Désamorcer la culture de l’égoïsme au profit d’un imaginaire de coopération. Les sciences sociales des catastrophes le montrent : panique généralisée et pillage sont des mythes. Ce qui sauve le plus de vies, c’est le capital social (voisins, associations, confiance envers les secours et institutions).
« Le problème, ce ne sont pas les pénuries : c’est la culture de la défiance. »
Pablo Servigne
Du survivalisme au “supervivalisme” : préparer sans se couper du monde
Le bunker isole, donc fragilise. L’entraînement utile est moins matériel que social : cartographier ses liens (forts/légers, horizontaux/verticaux), connaître ses voisins, ses élus, les pompiers ; partager des exercices (jeux sérieux, simulations), réactiver la mémoire du risque locale, organiser fêtes de quartier et entraide. C’est « tout bénéf » : même si la crise tarde, la vie s’améliore déjà.
Mode d’emploi, version courte
- Entretenir des liens légers (diversité = résilience) et densifier des liens forts (confiance = réactivité).
- Tisser des ponts avec institutions et secours : noms, numéros, procédures locales.
- Jouer aux catastrophes (sérieux, mais joyeux) : apprendre sans tétaniser.
- Partager outils sobrement : radios, kits premiers secours, cartographies, points de rassemblement.
« Mieux vaut s’entendre avec ses voisins qu’avec ses idées, le jour où ça tape. »
Pablo Servigne
Conclusion : sortir par le haut
On voudrait des certitudes et des plans quinquennaux. On a des interdépendances et des inconnues. Mais il y a des points fixes : la peur paralyse quand le lien est absent, la coopération réduit la casse, la joie rassemble. S’il faut un récit, le voici : devenir frères et sœurs avant la tempête. Tout le reste — technique, politique, économie — suivra la qualité de ce que nous tissons, ici et maintenant.
Citations clés
- « L’effondrement n’est pas un moment, c’est un processus. »
- « Agir comme si la catastrophe était certaine pour mieux l’éviter. »
- « Nous mangeons du pétrole : sans énergie fossile, l’agro-industrie s’arrête. »
- « Le capital social sauve des vies ; la panique généralisée est un mythe. »
- « Le survivalisme isole ; l’entraide est un supervivalisme. »