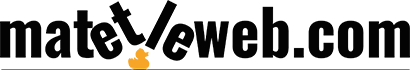Et si la santé n’était pas qu’une affaire de lits d’hôpitaux, de molécules et de courbes épidémiques, mais le cœur d’un projet de société ? Dans sa rencontre avec le médecin anesthésiste-réanimateur Louis Fouché, l’anthropologue de la santé Jean-Dominique Michel déroule, en creux, bien plus qu’une interview : une tentative de reconfigurer le rapport entre citoyens, institutions et pouvoir, à partir de ce que nous faisons – ou non – de nos corps et de nos vies.
Au fil de l’échange, la figure médiatisée du « docteur dissident » cède la place à quelque chose de plus complexe : le récit d’un médecin qui a vu le système de l’intérieur, s’y est brûlé, et tente désormais de transformer cette expérience en levier politique. Make Europe Healthy Again (MEHA) devient alors le nom d’un pari : faire de la santé un axe structurant de la démocratie européenne, contre la fuite en avant techno-industrielle.
Un réanimateur au bord du lit… et au bord du système
Louis Fouché commence là où tout médecin de réanimation vit : au bord du lit, entre vie et mort. Il raconte les gestes lourds – tubes, cathéters centraux, drains – exécutés pendant des années avec un mélange de technicité et d’anesthésie émotionnelle. Pour intuber, piquer, inciser, il faut apprendre à faire taire ses neurones miroirs, ces circuits de l’empathie qui nous font ressentir la douleur de l’autre.
Le paradoxe, explique-t-il, c’est qu’avec la crise Covid et ce qui a suivi, une partie de cette anesthésie a sauté. Il se surprend à ne plus supporter certains gestes qu’il faisait “comme un robot”. La réanimation, en le mettant face à des corps réduits à des paramètres, l’a longtemps éloigné du vécu de ces patients. La tourmente sanitaire et médiatique l’a fait revenir vers une question simple : qu’est-ce qu’on fait réellement à ces personnes, au nom de quoi, pour quel sens ?
« La médecine moderne m’a appris à couper la relation pour pouvoir agir. Ces dernières années, j’ai récupéré des neurones miroirs. Ça rend le métier plus difficile… mais plus humain. »
Ce retour de l’empathie n’est pas seulement une affaire psychologique : il ouvre une brèche politique. Si le malade n’est plus un “cas” mais un sujet, alors tout l’édifice logistique, industriel et bureaucratique de la santé se trouve remis en question.
La duplication numérique du patient : quand la data remplace la relation
Au cœur de la critique de Fouché, une idée revient comme un fil rouge : le patient a été remplacé par sa copie numérique. On ne voit plus une personne, mais un tableau de bord : tension artérielle, saturation en oxygène, kaliémie, créatininémie, scores de gravité. Le corps est converti en flux de données que l’on cherche à optimiser, prédire, contrôler.
Cette mutation technocratique n’est pas neutre. Elle traduit, selon lui, un basculement de notre relation au monde. D’un côté, une logique de maîtrise totale, obsédée par la prévision et le contrôle – celle des grandes plateformes, des agences sanitaires, des modélisations. De l’autre, une approche plus humble : accepter l’incertitude, écouter l’histoire singulière d’un être, reconnaître que la santé ne se résume pas à des chiffres.
« On veut gérer tout ce qui est prédictible dans le vivant. Mais vivre, c’est précisément ce qui déborde les modèles. »
La crise Covid, avec ses batteries de tests, ses protocoles standardisés et ses graphiques d’incidence, a poussé cette logique jusqu’à la caricature. L’entretien ne s’y attarde pas en chiffres ; il en montre plutôt les conséquences humaines : soignants épuisés, patients réduits à des flux, citoyens sommés d’adhérer à une vérité “scientifique” décrétée depuis le haut.
Science, religion et dogmes : quand la méthode devient cléricature
Jean-Dominique Michel et Louis Fouché partagent une intuition lourde : la science institutionnelle a pris la place de la religion. Non pas la science comme méthode – qui suppose doute, réfutabilité, controverse –, mais la science comme système d’institutions, de revues, d’agences, d’experts agréés.
Fouché tisse un parallèle avec une foi religieuse réduite à de “bonnes opinions”. Croire au bon dogme, ou répéter les éléments de langage officiels, ne garantit en rien une vie transformée ni une éthique à l’épreuve du réel. De la même manière, se draper dans des « études scientifiques » ne préserve pas de la corruption, des biais, de la peur de perdre sa place.
« La vraie foi, c’est ce qui a traversé l’épreuve. Quand la science devient une religion d’État, elle perd son âme : le doute. »
La critique est rude pour les institutions sanitaires : agences capturées par l’industrie, experts multi-conflits d’intérêts, revues devenues des espaces de guerre économique. Le propos ne cherche pas l’équilibre : il assume une posture de contre-pouvoir, quitte à laisser dans l’ombre les scientifiques et soignants qui tentent, de l’intérieur, de résister à cette dérive.
Vaccination de masse, polymédication : symptômes d’un système malade
L’un des terrains les plus explosifs de l’entretien reste la vaccination de masse et la polymédication. Fouché s’inquiète du nombre croissant d’injections administrées dès l’enfance, du modèle américain comme horizon implicite, et de l’empilement de traitements chez l’adulte : chaque effet secondaire devenant le prétexte à une nouvelle ordonnance.
Là où les autorités sanitaires mettent en avant le rapport bénéfice/risque des programmes de vaccination, lui insiste sur les effets indésirables insuffisamment pris en compte, sur la logique industrielle qui pousse à multiplier les produits, et sur l’aveuglement d’une médecine qui traite des segments de corps sans interroger le mode de vie, l’alimentation, l’environnement social.
« On ne prescrit plus pour soigner, mais pour réparer les dégâts de la prescription précédente. Quand on en est là, ce n’est plus de la santé, c’est de la maintenance industrielle. »
Cette critique radicale, très discutée dans le champ scientifique, est néanmoins cohérente avec le reste du tableau : une santé publique qui a cessé de s’intéresser aux causes profondes des maladies chroniques pour se concentrer sur la gestion infinie de leurs conséquences.
Make Europe Healthy Again : la santé comme programme politique
C’est ici que l’entretien bascule : la santé cesse d’être seulement un terrain de critique pour devenir un projet de transformation politique. Make Europe Healthy Again (MEHA) n’est pas présenté comme un parti, mais comme une matrice de programme : partir de la santé réelle des populations pour refonder les politiques publiques.
Jean-Dominique Michel rappelle à quel point le volet santé est central dans la politique américaine : Obamacare, Medicare, les débats sur les assurances privées, les campagnes de Trump ou de Robert F. Kennedy Jr. Dans cette configuration, un projet de santé alternatif n’est pas une niche : c’est un levier de pouvoir.
En Europe, au contraire, les systèmes de santé sont souvent sacralisés ou gérés comme de simples postes budgétaires. MEHA propose d’en faire un axe structurant de la souveraineté : reconquérir la capacité de décider de nos politiques de soins, de prévention, de pharmacovigilance, face aux intérêts industriels globaux et aux pressions géopolitiques.
« La santé, ce n’est pas un secteur parmi d’autres. Si on n’est pas capables de protéger les corps, les esprits et les liens, à quoi sert la politique ? »
Dans cette perspective, la santé devient un test de réalité : un pays qui sacrifie ses soignants, abîme ses hôpitaux et méprise ses malades peut difficilement se dire démocratique.
Réseaux, collectifs, syndicats : la contre-société en train de naître
Loin des grands discours, Fouché détaille aussi l’écosystème concret né de la crise : syndicats de soignants, groupes d’entraide, ONG informelles, collectifs locaux. Le Syndicat Liberté Santé défend des professionnels suspendus ou sanctionnés ; des structures comme Solidéclat accompagnent les victimes d’effets indésirables dans la jungle de la pharmacovigilance ; d’autres initiatives, comme Une autre santé, tentent d’articuler médecines conventionnelles et approches intégratives.
Beaucoup de ces organisations, reconnaît-il, se fracturent, se fatiguent, explosent parfois sous le poids des conflits humains. Mais ce qui tient, ce sont les petits groupes locaux : quelques dizaines de personnes qui se réunissent régulièrement, partagent leurs connaissances, réinventent des formes d’entraide, organisent des ateliers, des consultations, des rencontres.
« Ce qui survit, ce ne sont pas les grandes bannières, c’est le lien. Les petits collectifs, eux, continuent à se voir, à s’entraider. Là, il y a déjà un autre monde qui travaille en silence. »
Ces micro-sociétés esquissent ce que pourrait être une santé “municipaliste” : ancrée dans des territoires, portée par des citoyens, dialoguant avec – et non subordonnée à – l’appareil d’État.
Parler à trois mondes : citoyens, institutions, politiques
La stratégie esquissée au fil de la discussion repose sur un triptyque exigeant :
- Parler aux citoyens, d’abord, pour les sortir du rôle de consommateurs de soins et les rendre acteurs de leur santé, de leur milieu de vie, de leur alimentation, de leurs liens sociaux.
- Parler à l’intérieur du système, ensuite, à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les administrations, les agences, et qui se sentent de plus en plus mal à l’aise. Leur dire : « vous n’êtes pas fous, vous n’êtes pas seuls ».
- Parler aux politiques, enfin, en proposant des programmes concrets, chiffrés, structurés. Pas seulement dénoncer, mais mettre sur la table des alternatives viables.
C’est à cette intersection que se situe MEHA : un lieu de passage entre ces trois mondes, ni purement militant, ni purement académique, ni purement électoral. Reste à savoir si cette position hybride pourra peser face aux mastodontes pharmaceutiques et aux appareils d’État.
Une époque héroïque… ou la tentation de rester au fond
L’un des passages les plus forts de la rencontre est peut-être aussi le plus discret : quand Fouché décrit notre moment comme une époque héroïque. À mesure que « ça pue » – dérive autoritaire, guerre, surveillance, censure –, s’ouvre un espace où chacun est sommé de choisir sa place : spectateur tétanisé, rouage consentant, ou acteur, à son échelle.
Pour le dire, il mobilise des images mythologiques : Marduk affrontant le chaos primordial Tiamat, héros qui descend dans les profondeurs pour affronter le monstre ; Ulysse qui revient à Ithaque, méconnu, déguisé en mendiant, incapable de reprendre simplement sa place. Les dissidents de la crise sanitaire, explique-t-il, courent un risque : rester au fond, coincés dans la guerre, la dénonciation, la colère.
« Descendre affronter le monstre, c’est nécessaire. Mais si tu ne remontes pas, si tu ne retrouves pas les tiens, tu n’es pas un héros, tu es un fantôme. »
Le vrai enjeu, pour lui, n’est pas de gagner tous les combats symboliques ou judiciaires. C’est de revenir à la vie ordinaire avec quelque chose de sauvé : des liens, une foi plus profonde, peut-être l’embryon d’institutions nouvelles.
En filigrane : Gaza, la guerre et l’impossibilité de détourner le regard
En fin d’entretien, Jean-Dominique Michel évoque son travail sur Gaza, qu’il qualifie de génocide, et la nécessité d’oser regarder la violence politique en face. Le lien avec la santé n’est pas décoratif : bombardements, blocus, destruction des hôpitaux, famine organisée… La guerre est aussi un laboratoire de la destruction de la santé comme bien commun.
Ici encore, l’entretien ne se place pas sur le terrain du consensus. Il assume une lecture engagée, au risque d’être accusé de partialité. Mais ce choix souligne une cohérence : parler de santé sans parler de guerre, de colonialisme, de dépossession, serait, pour eux, une forme d’aveuglement moral.
Ce que raconte vraiment “Make Europe Healthy Again”
Au-delà des formules et des sigles, c’est un diagnostic sur l’époque que livre cette rencontre. Nous vivons dans des sociétés où :
- les institutions de santé ont perdu une partie de leur légitimité ;
- les corps sont devenus des marchés ;
- les crises (pandémies, guerres) servent de prétexte à des extensions de pouvoir ;
- des contre-sociétés se forment, de plus en plus structurées, mais encore fragmentées.
Make Europe Healthy Again ne prétend pas apporter la solution miracle. Le mouvement porte plutôt une question, brutale et simple : sommes-nous capables de refaire de la santé – au sens plein, physique, psychique, social, spirituel – le centre de nos décisions politiques ? Si la réponse est non, alors peu importe qui gouverne : la machine continuera à broyer des vies.
Si la réponse est oui, alors il faudra accepter plusieurs renoncements : moins de croyance aveugle dans la technique, moins de dépendance à l’industrie pharmaceutique, moins de confort dans la délégation à des “experts”. Et reconstruire, patiemment, à partir des petits groupes, des territoires, des hôpitaux de quartier, des villages, des collectifs.
C’est peut-être là que se joue le vrai sens de « Make Europe Healthy Again » : non pas un slogan nostalgique, mais une invitation à reprendre au sérieux ce que “être en santé” veut dire, à l’heure où l’on meurt aussi bien d’infarctus que de solitude, de virus que de décisions politiques.